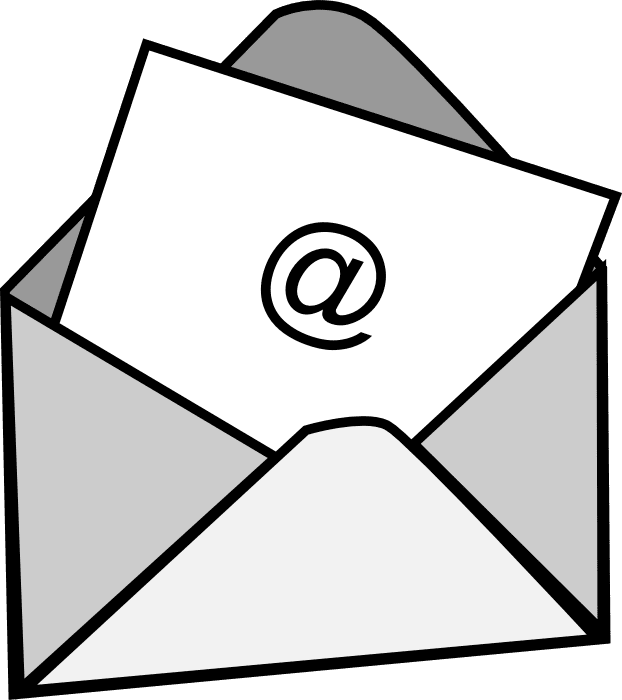Docteur en philosophie et en sciences sociales, hyperpolyglotte, écrivain, accompagnateur pédagogique à l’université catholique de Louvain et militant associatif, Josef Schovanec participe depuis quelques temps à l’émission Voyage en Autistan. Une série documentaire où il explore différents pays et partage son expérience unique en tant que personne autiste Asperger. Dans un récent épisode, il s’est rendu au Tadjikistan, où il a rencontré à Douchanbé, la capitale, notre partenaire local, Iroda.
Vous vous êtes rendus dans le café social** de notre partenaire Iroda à Douchanbé au Tadjikistan, qu’en avez-vous pensé ?
Plusieurs choses m’ont marqué. D’abord l’extraordinaire ambiance, très chaleureuse. Avec des familles issues de milieux différents et qui s’entendent très bien, se soutiennent. Les jeunes accompagnés ont eux aussi des profils variés. Ce que j’ai beaucoup apprécié. C’est parfois l’erreur qui est faite par les associations : ne s’occuper que d’un type de handicap bien défini alors que la mixité est importante.
Le côté moderne du café m’a aussi surpris. Alors que je m’attendais à un endroit austère avec quelques tables et chaises, je me suis retrouvé dans un lieu à la décoration soignée, très colorée. Un dernier point qui m’a beaucoup touché : les conversations des mamans auraient pu être celles de mamans françaises à quelques références ou mots près. « Que va devenir mon enfant quand je ne serai plus là ? Comment l’aider à développer ses compétences professionnelles ? Est-ce qu’on va lui trouver une école ? Comment faire pour parler de mon enfant différent à mon entourage ?... » Cela montre à quel point les réalités humaines sont les mêmes un peu partout. Le côté universel de la condition humaine est assez étonnant.
Justement que dire de l’inclusion en France ?
On parle mieux et on parle plus des questions liées au handicap et à l’autisme. Mais les beaux discours ne suffisent pas. Le décalage croissant entre ces discours et la réalité vécue crée de la frustration et de colère chez les familles. On voit, par exemple, se former des collectifs qui ne croient plus en l’inclusion scolaire.
Parmi les problèmes, il y a aussi la sur-bureaucratisation du monde du handicap. D’année en année, on a ajouté des organismes, des instances, des circulaires, des observatoires… Et les choses sont devenues ingérables et décourageantes pour les personnes concernées. Je ne sais pas si un café comme celui de votre partenaire à Douchanbé aurait pu ouvrir aisément en France. Il y aurait eu 1 001 obstacles sur le chemin. Je suis sûr qu’on aurait trouvé une place de parking manquante ou autre.
Y a-t-il des secteurs où les problèmes rencontrés sont plus importants ?
Le handicap est un miroir grossissant de ce qui ne va pas dans une société. Les problématiques que rencontrent les personnes handicapées ou autistes sont les mêmes que le reste de la population, mais en plus fort, en plus méchant. Un exemple, les problèmes de logement touchent beaucoup de monde – de plus en plus d’ailleurs, ce qui est inquiétant – mais les personnes handicapées y sont confrontées plus massivement.
Ainsi, je dirais que pour changer la situation de vie des personnes différentes, il faut réfléchir de façon bien plus vaste, bien plus globale, plutôt que de se concentrer uniquement sur des aspects spécifiques du handicap.
C’est-à-dire, à quoi pensez-vous ?
Il faut réfléchir à la place de l’être humain. La tentation dans certains pays occidentaux, c’est de donner un peu d’argent aux personnes en situation de handicap, en espérant qu’elles se taisent. Mais ce n’est pas une solution. Ce qui importe dans une vie, ce sont les interactions humaines. Le fait d’avoir une place dans la société, d’en être un membre estimé ou nécessaire. Et on est loin d’y être ! Il me semble qu’en matière d’inclusion, le gros boulot est devant nous.
Par contre, je crois en la possibilité de créer des solutions locales : des espaces d’inclusion. Je connais des gens qui font des choses extraordinaires, qui créent des environnements meilleurs et plus fonctionnels, avec peu de moyens.
Quel doit être le rôle de l’école ?
Le rôle de l’école devrait être d’enseigner à chaque enfant, chaque jeune « à être avec ». Il y a quelque chose qu’on ne peut apprendre en deux clics de souris, c’est comment fonctionner avec d’autres personnes qui ne sont pas comme moi. Cela devrait être le cœur de métier de l’école. Dès lors, la présence à l’école des enfants jugés différents a une utilité immédiate : apprendre aux autres enfants ce qu’est la diversité, comment on vit ensemble. C’est une chance pour tous de rencontrer dès le plus jeune âge une variété de profils humains.
Que mettre en place, selon vous, pour favoriser cet apprentissage du vivre ensemble ?
Il y a toute sorte de formations du personnel à développer, c’est une proposition classique. Une autre idée serait qu’il y ait des personnes différentes parmi les profs. Cette option serait une manière appropriée de transmettre une culture commune de la coexistence humaine. Les échanges du quotidien permettraient une forme de formation spontanée du corps professoral et des élèves.
Qu’en est-il de l’inclusion des élèves différents à l’école ?
Il faut s’interroger sur la raison pour laquelle une salle de classe devrait nécessairement être aménagée avec des chaises et de petites tables alignées. Qui a décidé de ça ? Si on exige qu’un élève avec un TDAH* se tienne pendant x heures par jour assis immobile, on ne va pas y arriver. L’engueuler n’y changera rien. D’ailleurs, un enfant avec un TDAH se fait engueuler 200 fois par jour. Bonjour l’estime de soi… Et si le problème venait de l’organisation de la salle qui ne correspond pas aux enfants ?
Il y a des pays dans le monde où, quand on arrive dans une classe, on jurerait que c’est une cuisine familiale. Pendant qu’on prépare un gâteau, avec des enfants debout, d’autres assis, on parle de l’histoire de je ne sais quel pays ou de mathématiques… Autre exemple : savez-vous à quel âge un jeune danois reçoit sa première note ? À l’université. Nous avons des idées préconçues auxquelles on s’accroche ; cela nous bloque. Alors qu’on pourrait imaginer un environnement scolaire beaucoup plus inclusif, qui serait aussi plus sympa pour les profs.
Un mot sur les programmes scolaires ?
C’est le même constat, la même question. Est-ce que le programme de l’Éducation nationale correspond réellement à ce que sont les enfants ? On pourrait imaginer un enseignement davantage tourné vers l’humain. Cela a l’air d’être un peu rêveur, mais pas vraiment. Il y a des compétences inclusives et humaines chez les jeunes, issus de tous les milieux, qui sont parfois bluffantes. On ne les valorise pas. C’est dommage. Ce sont des compétences dont notre société a bien besoin et qui sont utiles tout au long d’une vie et quel que soit le métier.
Un modèle qui me plaît serait, non pas un schéma scolaire unique, mais une pluralité des possibles, avec le postulat qu’il n’y a pas de voie plus prestigieuse ou meilleure, et que les envies de chacun sont prises en compte. La réalité humaine ne correspond pas aux fantasmes normatifs que notre société cherche à imposer dès le plus jeune âge. D’autant que cette réalité est plurielle. Il n’y a pas deux enfants pareils, handicap ou pas. Je crois qu’il y a un vrai problème de standardisation dans notre société.
Quelle est l’importance de poser un diagnostic ?
Quand on constate qu’il y a un problème à l’école ou dans la vie d’un enfant, on peut légitimement chercher un diagnostic, mais est-ce que le diagnostic va, par lui-même, résoudre le problème ? C’est une bonne question. Il y a de plus en plus d’enfants aujourd’hui qui ont une litanie de diagnostics. Je crois que toutes ces quêtes d’aménagement raisonnable, évidemment respectables, découlent du constat que notre société est devenue trop dure, trop excluante. Les parents essayent donc de protéger l’avenir de leur enfant. Mais, si vous êtes dans un modèle de société où chaque personne a naturellement une place, tout cela n’a pas beaucoup de sens.
Mais le fait de ne pas diagnostiquer ne peut-il pas entraîner de la souffrance ?
Oui, tout à fait. Mais la souffrance est causée par l’exclusion. C’est ça qui fait souffrir. Autrement dit, si les seules personnes qui trouvent un travail sont soit valides, soit reconnues comme travailleurs handicapés bénéficiant d’un quota spécifique imposé aux entreprises, alors oui, un diagnostic est indispensable. Sans cela, on se fait broyer. C’est notre société qui impose cette situation. Dans un modèle où chaque personne a naturellement une place, tout ça n’a pas beaucoup de sens.
*L’émission sera diffusée jeudi 3 avril à 23h sur Canal+.
**Ce café social, ouvert en juillet 2024, forme et emploie des jeunes en situation de handicap. Le lieu propose des zones sensorielles adaptées pour s’ouvrir à tous les publics.
***Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité.