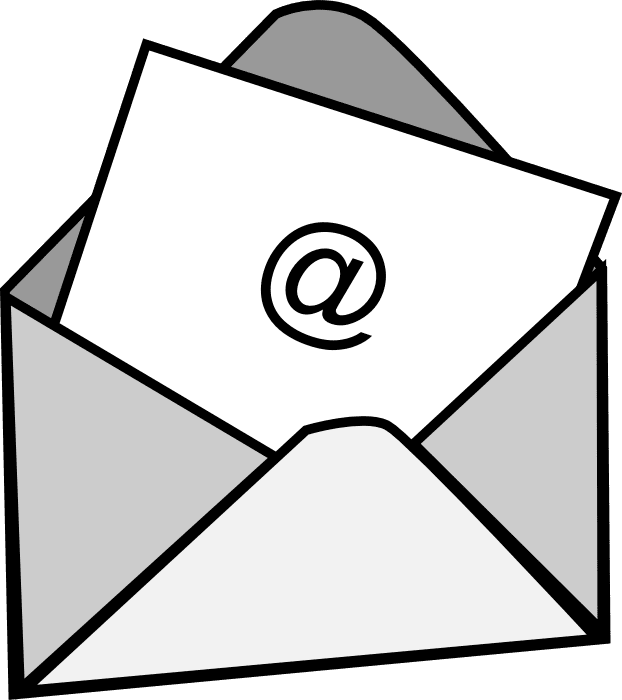Depuis des mois, les images de différents conflits tournent en boucle sur les chaînes d’information et les réseaux sociaux. Invasion de l’Ukraine, affrontements au Proche-Orient, insurrection au Sahel… Les jeunes générations peinent à comprendre ces embrasements internationaux. Et cherchent des réponses. Les discussions autour de ces événements électrisent parfois les débats. Des tensions qui n’échappent pas à leurs interrogations. Mais, comment expliquer aux enfants un concept aussi complexe que la guerre ? Pour les parents, la tâche peut sembler ardue, mais elle n’est pas insurmontable.
Écouter l’enfant
En février 2022, l’entrée des troupes russes sur le sol ukrainien rappelle à une Europe pensant avoir tourné la page des grands conflits l’éventualité d’une nouvelle guerre sur son propre sol. « Au moment du déclenchement du conflit en Ukraine, l’angoisse des parents a parfois déteint sur leurs enfants. Il est intéressant de noter que ces inquiétudes se sont davantage exprimées chez les patients les plus jeunes, les adolescents étaient moins concernés », expose le pédopsychiatre Stéphane Clerget, auteur de l’ouvrage L’intelligence spirituelle de votre enfant*.
Dans les mois qui suivent le début du conflit, Isa, installée en Loire-Atlantique avec sa famille, est rapidement confrontée aux interrogations de son fils de 10 ans. « Des élèves ukrainiens sont arrivés dans sa classe. Il m’a posé des questions, il voulait avoir plus de précisions. Désormais, il se questionne régulièrement sur les Première et Seconde Guerres mondiales. Il cherche à comprendre, explique-t-elle, avant de poursuivre : Je ne pense pas que ce soient des angoisses. Il ne comprend pas pourquoi des êtres humains en attaquent d’autres. Il estime qu’il faut avoir un problème psychologique pour agir ainsi. J’ai essayé de lui expliquer que cette pathologie n’existait pas. Je crois qu’il se sent rassuré d’y mettre le sceau de “l’anormalité”. »
Dans ces situations, les parents doivent faire preuve d’une attention particulière et ne pas minimiser les questionnements de leurs progénitures. Il est crucial que l’enfant puisse s’exprimer et livrer ses émotions sur le sujet. Derrière ces craintes légitimes, courantes à ces âges, peuvent se cacher des anxiétés plus profondes. « Quand l’état de souffrance de l’enfant ne s’améliore pas, j’invite les personnes concernées à consulter un médecin ou un psychiatre. Cela peut être un facteur déclenchant qui révèle une fragilité sous-jacente. Imaginons un enfant qui a déjà un tempérament anxieux, cela peut être l’élément déclencheur de troubles plus graves », analyse le psychiatre Nicolas Neveux, à la tête du site spécialisé e-psychiatrie.fr et auteur de L’hypersensibilité chez l’adulte**.
Des troubles anxieux en hausse
Depuis presque trois ans, les professionnels de santé constatent une hausse des troubles d’anxiété chez les plus jeunes. Si le sujet n’est pas nouveau et avait déjà été soulevé après les attentats du 13 novembre à Paris et lors de la pandémie de covid-19, les guerres peuvent raviver ou engendrer de nombreuses angoisses. Telle la crise au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023 qui touche, toutefois, davantage des enfants qui entretiennent un lien avec les territoires concernés.
Dans les écoles, le sujet s’invite parfois dans les conversations. À 11 ans, Théo est conscient du contexte qui l’entoure. Cela ne l’inquiète pas particulièrement, mais l’attriste. Surtout qu’il constate que son entourage est concerné. « J’ai une amie d’origine libanaise, de temps en temps, elle parle de la situation là-bas. Elle raconte que c’est compliqué pour sa famille. Elle a peur pour eux », détaille le garçon.
« Des patients ayant des proches en Israël ont développé de véritables angoisses. Elles ne sont pas alimentées par ce qu’ils voient, mais par ce qu’ils savent. Éventuellement, la télévision ou les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle. Mais ce qui angoisse d’abord les enfants, c’est l’éventualité qu’un membre de leur famille soit directement touché », insiste Stéphane Clerget. Dans certains cas, le dessin est un outil précieux. Le jeune patient peut formuler par l’image des émotions qu’il n’arrive pas à traduire par la parole.
Adapter son discours
Dans l’explication des conflits, les parents doivent choisir leurs mots et rester honnêtes sans minimiser les faits. Le discours dépend de l’âge de l’enfant. Pour les plus jeunes, il est conseillé de privilégier des explications simples et concises, tout en évitant de livrer des détails trop effrayants et difficilement compréhensibles. Il est nécessaire d’apporter une certaine rationalité dans le propos. Ainsi, on peut expliquer que des conflits existent et que des organisations oeuvrent pour répondre aux besoins d’urgence et tenter de restaurer la paix. Cette perspective est importante et permet de montrer que la résolution d’un conflit est possible.
Autour d’une dizaine d’années, les débats peuvent être plus poussés, mais l’enfant doit être protégé de tout propos ou image traumatisant. « On parle de l’actualité et des guerres à l’école entre copains, quand je rentre chez moi je pose des questions à mes parents parce que j’ai envie de savoir, de comprendre. Ils prennent le temps de m’expliquer et c’est bien. C’est rassurant », glisse Théo. Public plus mature, les adolescents possèdent davantage de bagage intellectuel pour comprendre ces actualités. Les échanges peuvent être plus profonds et les supports diversifiés. Documentaires, livres, conférences ou articles de presse correctement sourcés sont d’excellents outils de compréhension, voire de démystification.
Poser un cadre
Dans l’ensemble, le corps médical constate une implication précoce dans les questions inhérentes aux conflits au Proche-Orient. « On s’est aperçu que des enfants très jeunes qui n’avaient pas eu d’explications précises sur le sujet se sont retrouvés mis en demeure dans la cour de récréation par d’autres camarades qui, eux, étaient au courant et leur ont demandé de prendre position pour l’un des deux camps. Des enfants se sont trouvés perturbés à cause de jeux d’identité qui n’ont pas lieu d’être dans un établissement scolaire », explicite Nicolas Neveux.
Dans ce contexte, les enseignants jouent un rôle déterminant dans l’explication de ces conflits. À l’heure de la désinformation et de vifs débats entourant ces actualités, le corps enseignant doit régulièrement répondre aux demandes de leurs élèves. Professeur en banlieue parisienne depuis trois ans, Lucas enseigne l’histoire au lycée. « Au lendemain de l’invasion de l’Ukraine, il y avait une ambiance spéciale. Les élèves avaient beaucoup de questions et avaient besoin de précisions. J’ai ressenti de l’inquiétude chez certains d’entre eux. » D’emblée, le jeune professeur adapte ses cours, revient sur les grands moments historiques de l’ancienne république soviétique et offre ainsi de nouveaux outils de compréhension aux enfants. Le pédagogue répétera la même démarche concernant le conflit israélo-palestinien.
De leur côté, psychologues et psychiatres invitent les parents à poser certaines limites, notamment dans l’utilisation d’Internet. Actuellement, les discours tronqués ou les images traumatisantes pullulent sur la toile. L’enfance et l’adolescence sont des périodes durant lesquelles les premières opinions se forgent. « La protection de la santé mentale des enfants passe également par la régulation de l’accès aux écrans, tant en quantité horaire qu’en nombre de sites qu’ils peuvent visiter. Ce n’est pas l’outil le problème, c’est le cadre qui est important », martèle Nicolas Neveux.
*paru en 2021, aux éditions Leduc.
**publié aux éditions Mardaga