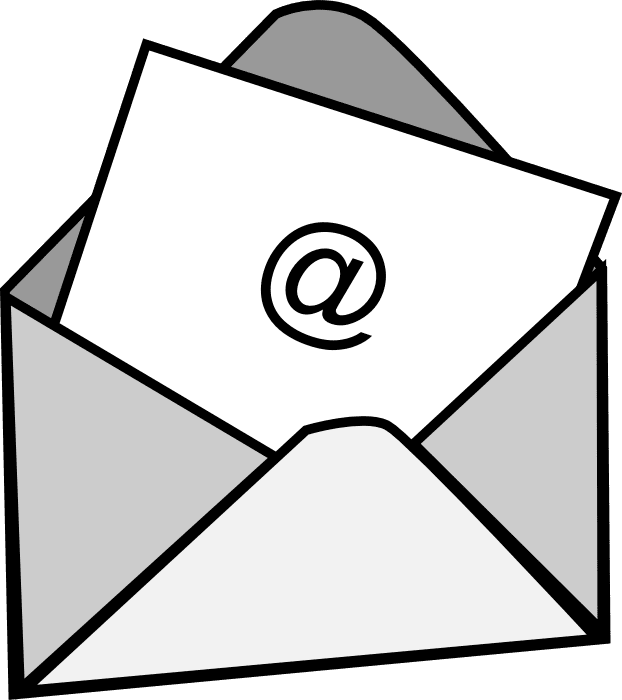Selon les estimations de l’Unicef, plusieurs dizaines de milliers d’enfants sont encore impliqués de manière directe ou indirecte dans des conflits armés. Notamment dans certains pays d’Afrique (République démocratique du Congo, Somalie, Soudan du Sud, Nigéria, Mozambique…), du Moyen-Orient (Syrie, Yémen…), d’Asie (Afghanistan, Myanmar) ou d’Amérique du Sud (Colombie) [1]. Les enfants soldats ne désignent pas seulement les très jeunes combattants mais aussi tous les enfants, garçons et filles (40 %), recrutés ou employés par une force ou un groupe armé (définitions de forces et groupes armés en encadré), ou dans le cadre d’affrontements entre bandes rivales. Des enfants utilisés comme cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou encore exploités sexuellement.
Le terme Enfant soldat désigne toute personne de moins de 18 ans faisant partie, à quelque titre que ce soit, d’une force armée ou d’un groupe armé, régulier ou irrégulier. Cela inclut, sans s’y limiter, les cuisiniers, porteurs, messagers et les personnes accompagnant ces groupes, sauf lorsqu’il s’agit exclusivement de membres de la famille. Sont également concernés les filles recrutées à des fins sexuelles ou en vue d’un mariage forcé. Le terme ne désigne donc pas uniquement un enfant portant ou ayant porté une arme.
Définition extraite des Principes du Cap (Cape Town, Afrique du sud, 1997)
Un phénomène ancien, qui s’accentue ces dernières années
Le phénomène des enfants soldats n’est pas nouveau. Déjà dans l’Antiquité, on en comptait – même si le terme n’est apparu qu’à partir des années 1980. À Sparte, les garçons entraient à l’âge de sept ans dans un système d’instruction militaire destiné à les préparer au combat dès la fin de l’adolescence. Au Moyen Âge, certains jeunes, notamment parmi la noblesse, pouvaient être envoyés sur les champs de bataille dès 13 ou 14 ans. Plus près de nous, durant la Première Guerre mondiale, dans certains pays belligérants, les adolescents de 16 à 18 ans étaient mobilisés afin de pallier le manque de soldats. Certains enfants volontaires, âgés de moins de 16 ans, décidaient eux de falsifier leur date de naissance et/ou leur identité pour s’engager au combat. « Pendant la Grande Guerre, il a existé une mobilisation militaire, non officielle, explique l’historienne Manon Pignot, dans une contribution parue sur The Conversation [2]. Un certain nombre d’adolescents – et, à l’Est, d’adolescentes – ont entendu l’appel à la mobilisation totale et ont tenté de rejoindre le front spontanément. » Pendant la Seconde Guerre mondiale, des enfants issues des mouvements de la jeunesse hitlérienne étaient appelés à soutenir l’effort de guerre en tant qu’estafettes ou pompiers par exemple. Puis, à partir de septembre 1944 et face aux défaites allemandes, la milice populaire embrigadait les enfants dès 16 ans pour combattre.
Ce recours aux enfants soldats s’est accentué après la seconde moitié du XXe siècle. D’abord parce que les conflits opposant armées régulières et guérilla se sont multipliés quand jusqu’alors les guerres opposaient surtout des armées conventionnelles. Ensuite parce que ces conflits perdurent plus longtemps. La durée des conflits au Guatemala, en Colombie, en Angola ou en Afghanistan… se comptent en décennies. Et les enfants sont utilisés pour compenser les difficultés de recrutements d’adultes.
Ajoutons que les enfants soldats sont des combattants recherchés. Ils sont plus vulnérables, malléables et influençables. Ils peuvent aisément être incités ou forcés à perpétrer des actes dont ils ne mesurent pas la gravité ou qu’un adulte pourrait ne pas faire pour des raisons éthiques ou morales. « Le recrutement d’enfants parmi les combattants répond alors à une véritable stratégie. En Sierra Leone, au Sri Lanka ou au Rwanda, les pires atrocités à l’encontre des populations civiles ont parfois été commises par des enfants », pointe Jean-Manuel Larralde, professeur de droit public à l’Université de Caen-Normandie dans la revue Les Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [3].
Des effets dévastateurs
Le plus souvent, ces enfants soldats ont été enlevés et recrutés de force, après avoir été drogués ou endoctrinés. Certains sont même obligés de terroriser ou de massacrer leur propre famille ou des personnes de leur propre village. Devenus parias et exclus de leur communauté, ils sont dès lors condamnés à rester avec leur groupe armé. Quand ils rejoignent ces groupes volontairement, c’est généralement parce qu’ils sont séparés de leur famille, déplacés pour des raisons de pauvreté ou n’ont plus aucune chance d’avoir un travail ou d’aller à l’école.
Dans tous les cas, leur quotidien d’enfant soldat est fait d’horreurs et de violences en tout genre. Réduits à la servitude, abusés et exploités sexuellement, ils sont privés de leurs droits fondamentaux (éducation et loisirs, santé, vivre en famille, protection…) et de leur enfance, quand ils ne sont pas tués, sans pouvoir se développer et construire un avenir.
« Le taux de mortalité de ces enfants est souvent élevé, en raison de leur manque d’expérience et d’entraînement, et du fait qu’ils sont utilisés pour des missions particulièrement périlleuses, comme le renseignement ou la pose de mines antipersonnel », relève le professeur de droit public à l’Université de Caen-Normandie.
Quand ils n’en meurent pas, leur utilisation dans les conflits armés a des effets dévastateurs. Ces séquelles sont durables dans le temps, parfois à vie, sur leur santé physique et psychique. Syndrome de stress post-traumatique, dépression, anxiété, sentiment de culpabilité ou de honte, difficultés à se réinsérer dans la société, blessures, malnutrition, isolement social, stigmatisation par leurs communautés (lire le témoignage en encadré).
Témoignage de Fabienne, 17 ans (2020)
« À 15 ans, alors que je rentrais des champs avec mes sœurs, j’ai été enlevée par des hommes armés. On m’a mariée avec le chef de ce groupe rebelle et je suis tombée enceinte. Lors d’un conflit au sein du groupe, le chef a été tué par son adjoint que j’ai ensuite dû épouser. Heureusement, un jour pendant des affrontements avec un autre groupe armé, j’ai réussi à m’enfuir. J’ai marché plusieurs heures, de nuit dans la brousse, avec mon bébé d’un an et demi dans les bras. Quand je suis enfin arrivée dans mon village, fatiguée, malnutrie, sale, ma famille m’a rejetée. Mon enfant et moi, nous représentions le mal, la honte. Nous étions montrés du doigt…
C’est un prêtre qui m’a parlé de Cœur sans frontières (CSF) un dimanche à la sortie de l’église. CSF m’a proposé de l’aide. J’ai accepté. Je suis allée avec eux à Goma. Ils m’ont trouvé une famille d’accueil et m’ont accompagnée sur le plan de la santé, sur le plan social, psychologique. Ils m’ont aidé à retrouver espoir en la vie, à accepter mon enfant que je n’aimais pas jusqu’alors, à m’accepter aussi. J’ai reçu une formation en couture puis du matériel pour lancer mon activité mais la pandémie m’a coupée dans mon élan. Ça a été dur. Aujourd’hui, avec ce nouveau projet, je retrouve espoir. »
Évolution de la protection juridique de ces enfants
Au fil des années, face à cette réalité qui perdure, la protection des enfants vivant dans des contexte de conflits, s’est étoffée. En 1949, la Convention de Genève, complétée en 1977 par des Protocoles additionnels, vise à protéger les personnes en temps de guerre, notamment les civils et les enfants. Adoptée par les Nations unies en 1989, la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) [4], dans son article 38, reprend les protocoles 1 et 2 de 1977. Elle exige notamment des États parties qu’ils « respectent et à fassent respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants… Et qu’ils prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. »
En 1996, l’assemblée générale de l’ONU crée le mandat de la Représentante spéciale du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés. Il sert à documenter les violations graves commises contre eux (recrutement, violences, attaques contre les écoles), à alerter la communauté internationale et à promouvoir des actions concrètes pour y mettre fin. Depuis avril 2017, ce mandat est exercé par Virginie Gamba. Dans un rapport publié en juin 2025, elle alerte sur une hausse de 25 % des six types de violations graves [5] commises contre les enfants en 2024 dans les conflits armés. Soit un total de 41 370.
En juillet 1998, l’adoption du Statut de Rome [6] (entrée en vigueur en juillet 2002) établit la Cour pénale internationale. Et introduit comme crime de guerre, au regard du droit pénal international, le recrutement, l’enrôlement ou l’utilisation d’enfants de moins de 15 ans dans des forces ou groupes armés [7]. Ce traité fait écho aux Principes du Cap rédigés en avril 1997 par l’Unicef, des ONG et des experts. Ces principes, non contraignants, portant sur la nécessité de prévenir le recrutement des enfants de moins de 18 ans, leur démobilisation et leur réinsertion, ont joué un rôle clé en sensibilisant sur la nécessité de protéger un large groupe d’enfants « associés », qu’ils soient combattants ou non, dans les conflits armés.
En 2000 (entré en vigueur en 2002), les États adoptent d’ailleurs le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC-OPAC) [8] qui marque une avancée majeure. Il élève notamment à 18 ans l’âge minimum recommandé pour tout recrutement dans les forces armées. Etinterdit tout recrutement par des groupes armés non étatiques, quel que soit l’âge [9].
Les Principes de Paris
En février 2007, à l’initiative de l’Unicef, une Conférence internationale consacrée aux enfants associés aux groupes et forces armés a élaboré les Principes de Paris. Ceux-ci actualisent les Principes du Cap et incitent à l’élaboration de nouveaux programmes de prévention (campagnes de sensibilisation, enregistrement des naissances…), de libération et de réintégration des enfants (accès à l’éducation et à la formation professionnelle, réintégration dans la communauté, aide psychosociale).
En 2024, 108 États en sont signataires. Plusieurs pays bénéficient de programmes de prise en charge par l’ONU et l’Unicef des enfants démobilisés : Angola, Burundi, Côte d’Ivoire, Ouganda, RDC., Rwanda, Somalie, Soudan… À leur échelle, le BICE et ses partenaires locaux, en RDC notamment, ont développé plusieurs projets en faveur de la réinsertion sociale et économique d’enfants soldats, filles et garçons, depuis plus de 10 ans. Des actions de soutien psychosocial sont également déployées.
Encore des défis
Reste que les programmes étatiques de démobilisation, de désarmement et de réinsertion de ces enfants sont insuffisants et que les enfants libérés le sont surtout du fait d’une cessation du conflit, et donc potentiellement « réengagés » quand celui-ci reprend. En parallèle de ces programmes, se posent aussi des questions en termes de droit international, relève Marie-Luce Desgrandchamps, historienne, co-directrice d’un projet de recherche sur l’histoire des enfants soldats sur le continent africain basé à Université d’Exeter, lors d’une émission consacrée au sujet [10] sur France Culture en février 2025 : « Comment est-ce qu’on juge ces anciens enfants soldats qui sont après devenus eux-mêmes des recruteurs ». À la fois, victime et bourreau. De la même manière, comment considérer les enfants qui sont nés et qui ont grandi dans les groupes armés ? Des sujets particulièrement difficiles et sensibles.
Différence entre groupe armé et force armée
Groupe armé
C’est une organisation non étatique qui recourt à la violence armée pour atteindre des objectifs politiques, idéologiques ou religieux. Il n’appartient pas aux forces armées d’un État et intervient généralement dans des conflits armés non internationaux (conflits internes). Lorsqu’il présente un niveau suffisant d’organisation (hiérarchie, discipline interne, commandement structuré, capacité à planifier et mener des opérations militaires), et qu’il affronte un autre acteur également organisé, il devient partie à un conflit armé non international au sens du droit international humanitaire. (Sources : Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Protocole additionnel 2 de la Convention de Genève (1977)).
Force armée
C’est l’ensemble des institutions militaires officielles d’un État (armée, marine, aviation), chargées de défendre le territoire et de maintenir la sécurité selon un cadre légal national et international. (Source : CICR)
Quels outils juridiques ?
Les outils juridiques ne sont pas exactement les mêmes selon qu’il s’agisse de forces armées étatiques ou de groupes armés non étatiques, mais le droit international impose des obligations à tous les acteurs engagés dans les conflits armés, y compris aux groupes armés, notamment en matière de respect du droit international humanitaire (DIH).
Concernant les forces armées :
-
- Elles sont directement soumises au droit international des droits humains en tout temps et au droit international humanitaire lorsqu’un conflit armé est en cours.
-
- Les États peuvent être tenus responsables devant des juridictions internationales (comme la Cour internationale de Justice) ou régionales (comme la Cour européenne des droits de l’homme).
-
- Les individus (militaires, responsables politiques) peuvent être poursuivis pénalement devant des tribunaux nationaux ou la Cour pénale internationale (CPI) pour des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des génocides.
Pour les groupes armés :
-
- Ils ne sont pas directement liés par le droit international des droits humains (car il s’applique aux États), mais ils sont soumis au droit international humanitaire, lorsqu’ils sont suffisamment organisés et impliqués dans un conflit armé, notamment à l’article 3 commun aux Conventions de Genève et, sous certaines conditions, au Protocole additionnel II (1977).
-
- Les membres de groupes armés peuvent être poursuivis individuellement pour des crimes internationaux (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, etc.), notamment devant la CPI ou des juridictions nationales.
-
- Certains mécanismes des Nations unies ou d’ONG peuvent documenter les violations et exercer des pressions (sanctions ciblées, enquêtes, rapports publics etc.).
[1] Notons que 473 millions d’enfants vivent aujourd’hui en zone de conflit, soit 1 enfant sur 6 dans le monde.
[2] Les enfants dans la guerre : regards sur un siècle de conflits, octobre 2024
[3] “Les réponses du droit international à la question des enfants soldats”, de Jean-Manuel Larralde, dans la Revue Les Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux (Presses universitaires de Caen, 2006).
[4] Ratifiée depuis par 196 pays.
[5] À savoir : le recrutement et l’utilisation, le meurtre et la mutilation, le viol et d’autres formes de violence sexuelle, les attaques contre les écoles et les hôpitaux, les enlèvements et le refus d’accès à l’aide humanitaire.
[6] 125 pays sont États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
[7] Pour ne citer que celui-ci, un procès a fait date en 2012. Celui de Thomas Lubanga Dyilo. Cet ancien chef d’un groupe armé en RDC a été condamné par la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye pour crime de guerre dans l’utilisation d’enfants soldats dans un conflit.
[8] 173 États sont parties au protocole.
[9] Notons que depuis 2002, le 12 février est la Journée internationale des enfants soldats, aussi appelée Journée de la main rouge, dédiée aux milliers de garçons et de filles enrôlés dans des groupes ou forces armés.
[10] Enfants-soldats : le dilemme du droit international, 12 février 2025