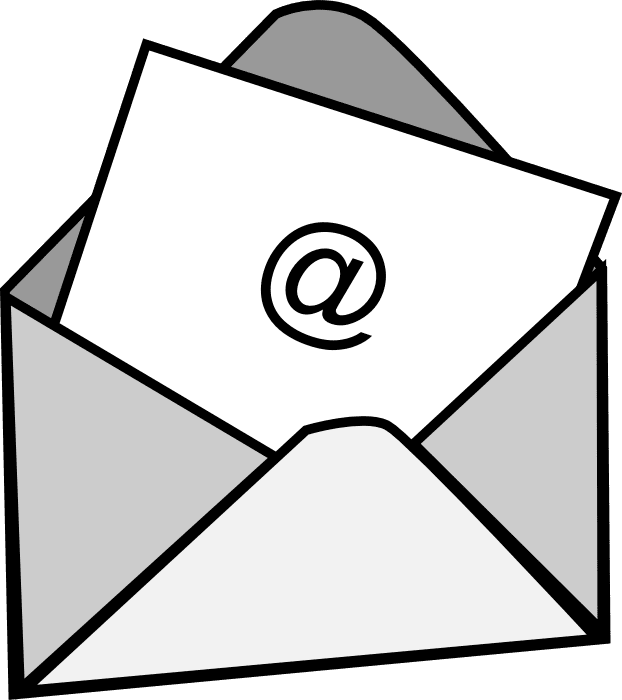Comprendre le plaidoyer : origine, définition et différence avec le lobbying
Le terme plaidoyer (advocacy en anglais) apparait au XXe siècle aux États-Unis*. Il peut être défini comme suit : « Le plaidoyer […] se réfère au moins à un style de promotion de causes et d’intérêts et à des formes légitimes de prise de parole pour les ONG internationales et locales »**. Il est souvent confondu avec le lobbying. Pourquoi ? Parce que les stratégies employées sont similaires (rendez-vous avec des décideurs politiques, présence dans les médias pour sensibiliser l’opinion publique, etc.). Quelle différence alors ? La cause défendue. Les plaideurs militent pour une vision du bien commun ou l’intérêt général (droits humains, écologie, justice sociale, etc.) tandis que les lobbyistes agissent pour un intérêt privé (industries agroalimentaires, pharmaceutiques, énergétiques, de l’armement, etc.). C’est pour cette raison que certains qualifient le plaidoyer de « lobby moral » et d’autres de « lobby non lucratif ».
Le plaidoyer vise un changement. Ce changement peut concerner les lois, les politiques publiques, les comportements, la gouvernance, les pratiques des institutions et les services de l’État. Il peut concerner aussi les opérations des entreprises.
Comprendre les différentes stratégies de plaidoyer à travers l’engagement du BICE pour la dignité et les droits de l’enfant
Plaidoyer international
Intervenir dans les instances internationales permet de mieux porter la voix des enfants dans les organes clés de supervision de la mise en œuvre des droits de l’enfant. L’objectif est d’influencer le cours des lois et des politiques publiques, mais aussi de garantir l’effectivité des droits de l’enfant tels qu’énoncés dans les différents instruments juridiques, au premier rang desquels figure la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations unies (CDE) et ses Protocoles facultatifs
En tant qu’expert sur les questions relatives aux droits de l’enfant, le BICE intervient dans différentes institutions internationales telles que le Conseil des droits de l’homme des Nations unies avec ses deux mécanismes majeurs que sont les procédures spéciales et l’Examen périodique universel (EPU). Le BICE porte également la voix des enfants auprès du Comité des droits de l’enfant de l’ONU qui supervise la mise en œuvre de la CDE et ses Protocoles facultatifs.Les actions de plaidoyer sont également menées auprès de l’UNESCO et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à Paris.
La force du BICE réside dans son réseau de 79 institutions lui permettant d’être au plus près des réalités du terrain. Par exemple, le BICE travaille de concert avec ses partenaires pour soumettre des rapports alternatifs à l’EPU et au Comité des droits de l’enfant. L’objectif est d’alerter sur les violations des droits de l’enfant dans un pays donné et de formuler des recommandations en vue de leur mise en œuvre.
Dans le cadre spécifique du Comité, ce rapport fait l’objet de suivi lors de la présession de cet organe afin de s’assurer que les préoccupations soulignées soient dûment prises en compte par les experts dans les questions formulées à l’endroit de l’État sous examen. Puis des briefings se tiennent avec les experts toujours dans le but de voir figurer dans les conclusions finales les sujets d’inquiétude et les recommandations qui vont avec. Ensuite pendant l’examen, le BICE invite son partenaire à Genève et travaille avec le secrétariat du Comité.
Plaidoyer à l’échelle locale et nationale
Le BICE et ses partenaires plaident également à l’échelle locale et nationale. En plus de sensibiliser aux droits de l’enfant, ils renforcent les compétences communautaires.
Par exemple, au Togo, pour lutter contre les violences sexuelles, le BICE et son partenaire appellent les autorités à changer les pratiques préjudiciables, sensibilisent et forment des chefs traditionnels, les conseillers municipaux, les directeurs préfectoraux des services sociaux et les enseignants. Autre exemple, au Paraguay et au Cambodge, dans le cadre du projet Écoles sans Murs portant sur l’accès à l’éducation dans des zones rurales, pauvres et isolées, un volet est consacré au plaidoyer auprès des communautés, des autorités locales et nationales avec la participation des enfants, sensibilisés à leurs droits.
Le BICE publie également diverses ressources afin de valoriser les bonnes pratiques de ses partenaires et de renforcer leurs compétences. Dans cette optique, un manuel de techniques de plaidoyer a été publié.
Groupes de travail et coalitions
Face à des enjeux communs, les ONG et les associations peuvent s’organiser collectivement, notamment à travers des groupes de travail et des coalitions. En coopérant, elles partagent des informations clés, des compétences, et ont plus de poids pour faire entendre leur voix.
C’est pourquoi, le BICE travaille avec d’autres organisations de la société civile pour faire respecter les droits de l’enfant. Il est notamment membre du groupe de travail sur la violence à l’égard des enfants au sein de Child Rights Connect, du Child Justice Advocacy Group, de la Dynamique pour les droits de l’enfant et du COFRADE. Il est également membre du panel d’ONG chargé de la mise en œuvre effective et du suivi de l’étude mondiale des Nations unies sur les enfants privés de liberté***.
Le plaidoyer médiatique
Les médias représentent un levier important pour promouvoir une cause. Ils jouent un rôle significatif dans la sensibilisation de l’opinion publique. Cette mobilisation a vocation à apporter les changements souhaités. Par leur large diffusion, les messages de plaidoyer dans les médias peuvent contribuer à faire pression sur les décideurs politiques, les incitant à adopter les mesures nécessaires.
Leur rôle est donc essentiel en matière de droits de l’enfant. À travers les médias, le plaidoyer peut mettre le projecteur sur des violations des droits garantis par la CDE. Plus de médiatisation, c’est potentiellement moins de violations. C’est dans cette optique que la société civile leur adresse des communiqués de presse dans l’espoir qu’un article ou une interview permette de mettre en lumière des enjeux cruciaux.
Conflits en Ukraine et en RDC, accès à l’éducation en milieu rural, isolé ou enclavé au Cambodge, au Guatemala et au Paraguay, formation et inclusion sociale et professionnelle de jeunes en situation de handicap en Géorgie et au Tadjikistan… sont autant de sujets qui ont fait l’objet de communiqués de presse ces derniers mois par le BICE.
Campagnes de sensibilisation via les réseaux sociaux
Ces campagnes sont intégrées dans les stratégies de plaidoyer. Les réseaux sociaux représentent aujourd’hui un outil puissant de sensibilisation et un espace où des interpellations peuvent être engagées à l’endroit des décideurs. Ils permettent d’alerter sur des violations. Pour cela, la société civile doit réaliser un véritable travail de vulgarisation des instruments juridiques ou d’une situation donnée pour que l’information soit accessible et digeste pour tous. Elle peut également interpeller les décideurs politiques, en les taguant, pour leur demander d’agir ou de rendre compte de leurs actes.
Les utilisateurs sur les réseaux sociaux n’ont pas qu’un rôle passif, qui consisterait à recevoir l’information. Ils peuvent devenir de véritables acteurs en sensibilisant à leur tour, en republiant du contenu par exemple.
Vous souhaitez en savoir plus sur les droits de l’enfant ? Sur le travail du BICE ? Être un citoyen engagé en relayant notre contenu ? Suivez nos réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram)!
*Ollion, É. (2015), « Des mobilisations discrètes : sur le plaidoyer et quelques transformations de l’action collective contemporaine », Critique internationale, 67(1), p.20.
**Siméant, J. (2014), « Interpreting the rise of international “advocacy” », Humanity, 5(3), p.324. (traduction libre).
***Nations unies (2019). The United Nations global study on children deprived of liberty. Disponible à : https://omnibook.com/view/e0623280-5656-42f8-9edf-5872f8f08562/page/1