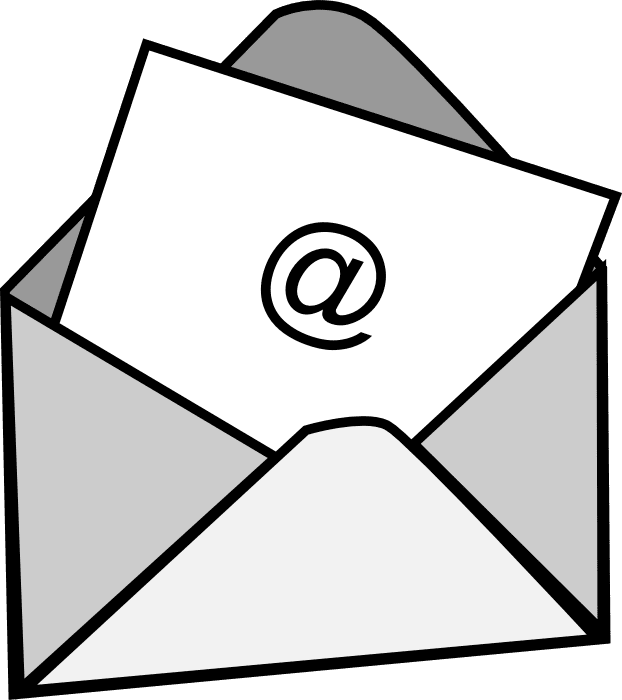Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), entre le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, et janvier 2024, les pertes civiles dans le pays se sont élevées à 10 378 tués, un chiffre sans doute en dessous de la réalité. Derrière chacune de ces morts, il y a forcément un ou des enfants dans la peine et l’effroi. Pour certains il s’agissait d’un père, d’une mère ou des deux. On comptait déjà plus de 100 000 orphelins ukrainiens en janvier 2022, avant le début de l’invasion russe de l’Ukraine. Ils sont désormais au moins 9 000 de plus selon les services sociaux du pays.
L’innocence face au deuil
Si les décès annoncés, consécutifs à une maladie par exemple, s’apprivoisent peu à peu par des phénomènes de pré-deuil, les morts brutales sont difficiles à appréhender pour les enfants. C’est ce qu’explique Hélène Romano, psychologue clinicienne et spécialiste du traumatisme chez l’enfant.
« Les enfants ne comprennent pas que la mort est irréversible. »
« Avant huit ou neuf ans, un enfant qui n’a jamais été confronté à la mort n’a pas conscience que celle-ci est universelle. Dans son esprit, la mort c’est pour les méchants, les faibles. À ces âges, les enfants pensent que la mort s’attrape. Si papa est mort, se disent-ils, maman va mourir aussi. Ils ne comprennent pas non plus que la mort est irréversible, que la perte est définitive. C’est pourquoi ils ne vont pas forcément réagir tout de suite. » D’où l’importance de ne pas recourir à des formules comme « papa est parti » qui sous-entendrait qu’il va revenir. Dire les choses donc, et contextualiser, insiste aussi la psychologue. « Dire “papa est mort”, c’est extrêmement violent. Il faut l’annoncer par paliers, pour que psychiquement, l’enfant sache où il en est. »
La complexité du deuil en temps de guerre
Dans un contexte de guerre, quand tous les repères volent en éclat, la douleur du deuil ne vient pas seule. « Le deuil au sens de perte est multiple, constate Hélène Romano, qui a accompagné des enfants scolarisés à Kiev. Les enfants doivent, au moins temporairement, faire le deuil d’un pays en paix, le deuil aussi de leurs repères, ce qui est très violent. À l’école, ce n’est plus comme avant, les maisons sont détruites, on ne mange plus la même chose. Ce qui est très compliqué également pour les enfants, c’est le manque de disponibilité des adultes, souvent envahis par l’angoisse et la peur. »
Pourtant, comme l’observe Maryna Fateeva, psychologue au centre Voice of Children de Tchernihiv, une ville du Nord du pays, le processus de deuil en lui-même reste étrangement immuable. « Nous gérons un groupe de soutien à des mères qui ont perdu leur enfant à cause de la guerre ou d’autres circonstances, raconte-t-elle. Nous ne remarquons pas de différence dans le deuil. C’est la même chose avec les enfants. Comme en temps de paix, leur capacité à vivre le deuil dépend de caractéristiques individuelles : leur résistance au stress, leur sensibilité, la présence ou non de proches pouvant les soutenir.
Autant de deuils qu’il y a d’enfants
Aux ressources propres à l’enfant, à celles de son entourage, s’ajoute un autre facteur, celui du contexte du deuil. « Il y a presque autant de modalités de deuil que d’enfants ukrainiens, souligne en effet Hélène Romano. Il y a ceux qui sont partis d’Ukraine et vivent loin de leur famille, dans une autre langue. Parmi ceux qui sont restés, certains ont gardé leur appartement, leur rythme scolaire, d’autres ont absolument tout perdu. Des enfants ont vu des proches mourir, des corps dans un état épouvantable. Ces deuils qu’on appelle post-traumatiques sont particulièrement à risque de développer des troubles. »
Ces traumatismes-là sont fréquents actuellement en Ukraine. « Dans de tels cas, nous apportons un soutien psychologique à toute la famille, et notamment à l’adulte qui est désormais responsable de l’enfant, explique Maryna Fateeva. Ces traumatismes nécessitent des interventions profondes en individuel, mais aussi en groupe, pour la stabilisation et le renouvellement des ressources psychologiques. Nos psychologues travaillent sur les lieux qui ont été bombardés (dès qu’ils sont sécurisés) pour fournir un soutien SMSPS* à ceux qui en ont besoin. »
Quand la médiatisation s’en mêle
Il y avait beaucoup d’orphelins parmi les enfants ukrainiens accueillis en France. Un formidable élan de solidarité néanmoins à double tranchant, comme Hélène Romano a pu l’observer dans sa pratique. « La médiatisation a tendance à hiérarchiser les deuils, c’est redoutable, comme si certains avaient plus de valeur. On a eu dans les consultations des priorisations pour les orphelins d’Ukraine, mais à la place de qui ? » Aujourd’hui, ces enfants doivent faire le deuil de l’immense attention dont ils ont bénéficié. « Ils peuvent vivre comme un rejet extrêmement violent l’envie que ressent une partie de l’opinion publique de passer à autre chose, presque d’éviter ceux qui sont la trace des horreurs de la guerre » s’inquiète la psychologue. Elle évoque le cas d’un enfant puni à l’école parce qu’il parlait à ses copains du dragon qui avait tué son papa et pris sa maman.
Pourtant, il est extrêmement important de les autoriser à parler de ceux qui sont morts et aussi de leur vie d’avant. Car « si on se réfère aux études faites sur les conflits antérieurs, conclut Hélène Romano, on constate que ce qui fait souvent la différence dans la façon de dépasser, d’apprivoiser le deuil, ce sont la force et la capacité des adultes à prendre en charge ces enfants et à les rassurer, sans nier les horreurs ni banaliser les choses, ni la souffrance. »
*Le terme Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS) sert à décrire tout type de soutien visant à protéger ou à promouvoir le bien-être et/ou à prévenir ou traiter un trouble mental.
« La foi apporte l’espérance d’un chemin de paix au-delà des souffrances endurées. »

À Ivano-Frankivsk, à l’ouest de l’Ukraine, j’ai rencontré un petit garçon de sept ans. Il était en train de préparer un sandwich. Je le voyais étaler lentement la sauce, comme s’il peignait un tableau, et j’ai tout de suite reconnu une grande douleur. Plus tard, j’ai su qu’il avait perdu ses parents dans l’effondrement de leur immeuble.
Le Pape François nous encourage à redonner le sourire à ces enfants pour qu’ils puissent rêver à nouveau. Il nous exhorte à créer des occasions d’amitié. C’est ce que j’ai vu à l’oeuvre à la Maison de charité de Lviv qui accueille des orphelins. Les prêtres du diocèse s’y rendent tous les dimanches. Plus que le personnel de l’établissement qui change très souvent, ce sont eux qui assurent la permanence du lien, nécessaire aux enfants.
La foi apporte l’espérance d’un chemin de paix au-delà des souffrances endurées. Nous le disons aux psychologues des centres que nous soutenons : il faut considérer l’enfant dans sa dimension physique, psychique mais aussi spirituelle. La CICM a aussi un programme dont le but est de donner des notions de santé mentale aux séminaristes ukrainiens, afin qu’une fois prêtres, ils sachent reconnaître les personnes qu’il faut orienter vers un psychologue.
Au commencement de la guerre, il y a eu des fosses communes, plus maintenant. C’est très impressionnant de voir, aux abords de chaque ville, les nouvelles tombes avec la bannière ukrainienne. J’ai visité dans l’est du pays une grande église transformée en mémorial de guerre : quand il n’y a pas de corps, les militaires y déposent un éclat d’obus, des bottes, une veste tachée de sang. Les proches viennent s’y recueillir, comme dans un cimetière. La ville organise aussi de grandes processions où l’on récite les noms des personnes tuées pendant l’année. C’est précieux pour les enfants de pouvoir, d’une manière ou d’une autre, rendre hommage à leurs morts.
Pour poursuivre la réflexion sur ce sujet : Les enfants et la Guerre de Hélène Romano, Éditions Odile Jacob