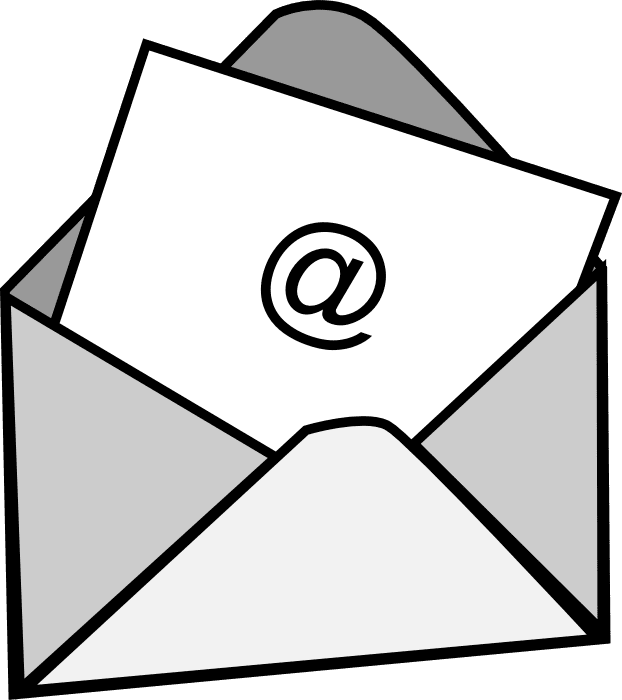Fast fashion, le terme est bien trouvé pour décrire le modèle économique de nombreuses enseignes de prêt-à-porter apparues au début des années 1980. Produisant toujours plus à des prix toujours plus bas (entre 2000 et 2021, la production de vêtements a doublé2), ces marques se sont engouffrées dans un engrenage concurrentiel infernal. De quatre collections par an, on est passé à une par mois, puis par semaine, et même par jour, comme en proposent les nouvelles marques disponibles uniquement en ligne et auxquelles beaucoup d’adolescents sont littéralement « accros ».
Les chiffres donnent le tournis. D’après le Collectif Fashion revolution3, si l’industrie textile s’arrêtait de produire aujourd’hui, l’existant permettrait d’habiller la planète jusqu’en 2100. Une surproduction qui représente, à l’échelle mondiale, quatre millions de tonnes d’émissions de CO2 par an (plus que l’ensemble du trafic aérien et maritime mondial).
Le droit à vivre dans un environnement sain bafoué
Pour réduire toujours davantage les prix, les marques ont délocalisé leurs productions dans de nombreux pays d’Asie comme la Chine dès la seconde moitié du XXe siècle, puis des pays d’Asie du sud et du sud-est comme l’Inde et surtout le Bangladesh à partir de 2019, plus récemment en Éthiopie. Ce sont ces populations, et leurs enfants, qui font directement les frais de l’impact environnemental d’une industrie responsable de 20 % de la pollution des eaux mais aussi des sols selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Une industrie qui, toujours selon l’Ademe, génère en outre quatre millions de tonnes de déchets textiles rien qu’en Europe. Une grande partie de ceux-ci est expédiée en Afrique et notamment au Ghana où la plupart s’entasse dans des décharges à ciel ouvert ou s’amalgame de façon inextricable au sable des plages.
Un système qui pousse au travail des enfants
Le travail des enfants dans les usines textiles résulte de la logique du toujours moins cher… à n’importe quel prix. « Si les ouvriers du textile gagnaient un salaire correct et bénéficiaient d’une protection sociale décente, constate Bogu Gojdź, coordonnatrice de la sensibilisation du grand public chez Clean Clothes Campaign4, ils n’auraient pas à envoyer leurs enfants travailler. C’est ce que documente une étude BILS5 réalisée en 2023 au Bangladesh : 100 % des travailleurs interrogés déclarent que leurs salaires sont trop bas pour qu’ils puissent nourrir leur famille pendant tout le mois.
Résultat : un grand nombre de travailleurs – environ 15 % selon les données de l’étude – se voient contraints, à leur corps défendant selon 97 % d’entre eux, de retirer leurs enfants de l’école et de les mettre au travail. Environ un quart (23 %) des travailleurs interrogés par BILS disent d’ailleurs avoir eux-mêmes commencé à travailler dans l’industrie du vêtement lorsqu’ils étaient enfants, principalement en raison du revenu insuffisant de leurs parents. Il s’agit d’un cercle vicieux qui ne peut être brisé tant que les ouvriers ne recevront pas un salaire décent. »

Une prise de conscience internationale
Dès la fin des années 1990, plusieurs grandes enseignes ont été épinglées pour l’emploi d’enfants dans les ateliers de leurs sous-traitants. Et ce, à des cadences et des conditions de sécurité inacceptables. En 2013, l’effondrement de l’usine textile Rana Plaza, près de Dacca au Bangladesh, a provoqué un véritable électrochoc. Faisant plus de 1 100 morts dont de très nombreuses jeunes filles, il compte parmi les catastrophes les plus meurtrières de l’histoire du travail.
Nées de ces scandales, des initiatives comme Fashion revolution, Clean Clothes Campaign et sa déclinaison française Éthique sur l’étiquette ont permis d’éveiller les consciences chez les consommateurs et de faire bouger les lignes au niveau des États. La Convention n° 138 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l’âge minimum du travail des enfants a été ratifiée par la Chine et l’Éthiopie en 1999, le Pakistan en 2006 et enfin le Bangladesh en 2022. Un progrès tout relatif dans ce dernier pays où l’âge légal de travail minimum est fixé à 14 ans, sans que les petites entreprises soient concernées.
L’impact en trompe l’œil des normes RSE
Les entreprises sont bien conscientes désormais de l’importance de leur responsabilité sociétale (RSE) et de l’impact qu’elle peut avoir sur leur image de marque. La prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques, à toutes les étapes de la chaîne de production, tend à leur être imposée par des directives toujours plus contraignantes. Un projet de loi de la Commission européenne prévoit que d’ici 2030, les marques soient tenues de produire, de manière éthique, des vêtements durables et dépourvus de produits chimiques dangereux. Mais dans un secteur aussi concurrentiel que l’industrie textile, cette vigilance est à double tranchant.
Peu à peu, les chaînes de sous-traitance se sont allongées, rendant tout contrôle et traçage quasiment impossibles (voir également encadré sur le secteur des cosmétiques). En 2016, un rapport de Business and Human Rights Resource Centre6 révélait la présence d’enfants réfugiés syriens dans trois usines de textile en Turquie. Si les enseignes H&M et Next ont tout de suite réagi, l’ONG déplore que pour bien d’autres grandes marques de vêtements, « ces travailleurs réfugiés semblent invisibles et loin de leurs préoccupations ».
Se responsabiliser en tant que consommateur
La meilleure garantie contre tous les abus, écologiques et humains, reste le changement d’attitude des consommateurs. Acheter moins et mieux, réfréner les achats d’impulsion, privilégier les marques « éthiques » et le « seconde main », penser à réparer, louer ou faire du troc. Cela peut s’apprendre dès le plus jeune âge, par exemple en recourant au test du BISOU que proposait Catherine Dauriac, présidente de Fashion Revolution France, dans une interview au site Vert.
« On commence par interroger le Besoin que l’on a de ce vêtement, avant de voir si ce besoin est Immédiat et s’il n’existe pas une pièce Semblable dans son vestiaire. Il s’agit aussi de s’interroger sur l’Origine du produit et ses conditions de fabrication, et enfin sur l’Utilité réelle que l’on va en retirer. Une fois ces cinq questions posées, en principe le besoin d’acheter est passé. » Une façon ludique de faire sa part dans l’avènement d’un monde plus respectueux de tous les enfants.
*Mode rapide
2 Fake or not – Fashion, de Catherine Dauriac
3 Collectif créé en 2013
4 Réseau d’organisations syndicales et d’ONG fondé en 1989 en vue de promouvoir le respect des droits humains, notamment du droit du travail dans les industries du textile
5 Bangladesh Institute of Labour Studies
6 Une ONG pour la responsabilisation des entreprises aux questions de droits de l’Homme
La face cachée de notre beauté
Minerai se présentant sous forme de plaques scintillantes, le mica apporte du brillant aux rouges à lèvres, fards à paupières et autres produits de beauté.
On le trouve dans le sous-sol des États de Bihar et Jharkhand, parmi les plus pauvres d’Inde, mais aussi à Madagascar. Il est extrait par des enfants âgés parfois de seulement cinq ans qui travaillent avec leurs parents jusqu’à douze heures par jour dans des mines pouvant atteindre 250 mètres de profondeur. Il s’agit là de l’une des pires formes de travail des enfants, et aussi une des moins visibles. La plupart des mines sont en effet illégales, notamment en Inde où elles ont été officiellement fermées en 1980 pour stopper la déforestation.
Selon une étude de l’ONG Terre des hommes, environ 22 000 enfants travaillaient dans les mines indiennes avant la pandémie de covid-19. En raison de cette dernière et de la fermeture des écoles qu’elle a entraînée, ce chiffre aurait encore augmenté depuis. Acheté treize centimes le kilo, le mica est souvent la seule source de revenus (misérables) des habitants de ces régions. Il est ensuite acheminé vers la Chine qui le revend aux marques de cosmétiques, via toute une chaîne particulièrement opaque de grossistes, tailleurs et intermédiaires qui, tous, nient avoir recours au travail des enfants dont ils savent parfaitement qu’il est interdit.